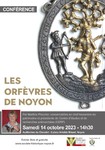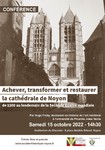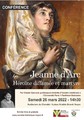Les conférences depuis 2020
Samedi 18 mai 2024 - Sylvain Dufraisse
Une histoire sportive de la guerre froide
Conférence donnée par Sylvain Dufraisse, maître de conférences à Nantes Université.
Dès le début de la guerre froide, l’évolution des rapports géopolitiques entre l’Est et l’Ouest a favorisé l’instrumentalisation du phénomène sportif. Dans un contexte où l’affrontement direct, c’est-à-dire militaire, devait être évité à tout prix en raison de la menace nucléaire, le sport est devenu très logiquement un lieu d’expression privilégié de l’antagonisme des deux superpuissances.
La séance en présence de 30 personnes s'est clôturée avec une séance de dédicaces de son ouvrage organisée en partenariat avec la librairie Dallongeville Gerboux.
Samedi 13 avril 2024 - Tal Bruttmann
Un album d’Auschwitz. Comment les Nazis ont photographié leurs crimes
Conférence donnée par Tal Bruttmann, historien spécialiste des politiques antisémites en France pendant la Seconde Guerre mondiale et de la « solution finale ».
Entre mi-mai et début juillet 1944, des centaines de milliers de Juifs de Hongrie sont déportés à Auschwitz-Birkenau. Pour montrer à leur hiérarchie la « bonne mise en œuvre » de cette opération logistique d’envergure, des SS photographient les étapes qui mènent de l’arrivée des convois jusqu’au seuil des chambres à gaz, ou au camp pour la minorité qui échappe à la mort immédiate.
Ces photographies, connues sous le nom d’« Album d’Auschwitz », ont été retrouvées par une rescapée, Lili Jacob, à la libération des camps, avant de servir de preuves dans différents procès et de faire l’objet de plusieurs éditions. Certaines de ces photographies sont même devenues iconiques. Par-delà l’horreur dont elles témoignent, ces images restent pourtant méconnues et difficiles d’interprétation.
La séance en présence de plus de 50 personnes s'est clôturée avec une séance de dédicaces de son ouvrage organisée en partenariat avec la librairie Dallongeville Gerboux.
Samedi 9 décembre 2023 - Jean-François Delmas
Florilège bibliophilique et graphique du château de Compiègne
Conférence donnée par Jean-François Delmas, conservateur général du patrimoine en charge du cabinet des arts graphiques et bibliothèques du château de Compiègne.
Parmi ses collections muséales très variées, le château de Compiègne conserve des fonds de bibliophilie, d’archives et d’arts graphiques ainsi qu’une riche documentation. Les thèmes se concentrent sur l’histoire de l’art des XVIIIe et XIXe siècles. Des sections plus spécifiques concernent l’histoire et la société du Second Empire, évocation de la présence régulière de la cour à Compiègne durant la période, notamment lors des célèbres « Séries ».
A l'occasion de cette communication, Jean-Claude Lecuru a fait don de quatre ouvrages provenant des bibliothèques du château achetés aux enchères. Ils regagneront définitivement leurs rayonnages.
Samedi 18 novembre 2023 - Lionel Arsac
Les jardins de Versailles : le paradis de la sculpture
Conférence par Lionel Arsac, conservateur au département des sculptures du château de Versailles
Dès les premiers aménagements du domaine hérité de son père, Louis XIV accorde à la sculpture des jardins une place qui ne cesse dès lors de s’accroître. Par
l’intermédiaire de la Surintendance des Bâtiments du roi, le monarque passe commande aux meilleurs artistes de groupes, figures, termes, bustes ou vases de marbre, de bronze ou de plomb. De 1664 à
1715, il n’est pas une année qui n’ait été marquée par la réalisation de sculptures pour Versailles, qui devient ainsi le plus haut lieu d’expression de la sculpture française, admirée et copiée dans
toute l’Europe.
Intrinsèquement liée à l’art des jardins dont elle forme l’ornement, la sculpture est également porteuse de sens : l’évolution de son iconographie reflète les transformations du domaine royal. À la
mythologie galante du premier Versailles des fêtes succède la thématique apollinienne, le dieu solaire et ses actions bénéfiques symbolisant Louis XIV garant du bon ordre du monde. Après 1682, date
de l’installation définitive de la cour à Versailles, désormais siège du gouvernement, la portée politique de la sculpture s’accentue. Outre les thèmes allégoriques, des antiques ou des copies
d’antiques font de Versailles une nouvelle Rome et participent au prestige de la monarchie.
Samedi 14 octobre 2023 - Martine Plouvier
Les orfèvres de Noyon
Conférence par Martine Plouvier, conservatrice en chef honoraire du patrimoine et présidente du Centre d’études et de recherches prémontrées (CERP).
La communication proposait de retracer l’histoire de l’orfèvrerie produite en Picardie - Monnaie d’Amiens - depuis le Moyen Âge jusqu’au début du XIXe siècle. La juridiction d’Amiens comprenait quinze villes et s’étendait de Calais à Noyon (Abbeville, Amiens, Blangy-sur-Bresle, Boulogne-sur-Mer, Calais, Chauny, Ham, Montdidier, Montreuil-sur-Mer, Nesle, Noyon, Péronne, Roye, Saint-Quentin et Saint-Valéry-sur-Somme).
La documentation et les pièces représentatives de la région picarde ont été réunies peu à peu sur une durée de quinze ans. Elles apportent une meilleure connaissance sur le métier d’orfèvre d’Ancien Régime et éclairent tant les rapports professionnels entre les commanditaires et les orfèvres que les relations, souvent tendues, avec les institutions. 1150 orfèvres ont travaillé pour les quinze jurandes et ont laissé des œuvres de qualité, dont il reste aujourd’hui à peine 0,5% en orfèvrerie religieuse et civile : 500 pièces, souvent dispersées et peu accessibles. Les trésors d’Amiens, Longpré-les-Corps-Saints, Saint-Valéry-sur-Somme, Montreuil-sur-Mer sont dévoilés aux chercheurs, collectionneurs, conservateurs et amateurs et recèlent des richesses artistiques exceptionnelles qui ont traversé les guerres et les révolutions.
Noyon y tient une place particulière, avec sa cinquantaine d’orfèvres œuvrant du XIIe au XIXe siècle, sa quarantaine d’œuvres recensées à ce jour et la qualité de quelques pièces originales comme un collier d’arc, une aiguière et son bassin miniature, une coupe à deux anses, des bassins à burette, un pot à oille, etc.
Samedi 3 juin 2023 - Corine Defrance
Françoise Frenkel, portrait d'une inconnue
Conférence par Corine Defrance, directrice de recherche au CNRS, enseignante à l’université de Paris 1 - Panthéon-Sorbonne et spécialisée dans l'histoire franco-allemande, a enquêté pendant cinq ans sur Françoise Frenkel en partant sur ses traces à travers l'Europe, de la Pologne au sud de la France.
En 2015, après soixante-dix ans d'un long oubli, le livre Rien où poser sa tête de Françoise Frenkel est redécouvert en France. L'impressionnant parcours de cette femme nous parvient miraculeusement intact, sa librairie française à Berlin, sa fuite dans la France occupée, la déportation à laquelle elle réussit à échapper, son passage en Suisse. Le livre connaît un succès immédiat et est traduit dans plus de onze langues.
Ressuscité, son nom fait surgir de nouveaux documents. Lettres, archives de police et d'Etat provenant de tous les pays qu'elle a traversés, carton d'inédits conservé pendant quarante ans dans sa famille suisse, publications datées d'avant et après la Seconde Guerre mondiale.
Mercredi 25 avril 2023 - Pascal Blanchard
Colonisation & Propagande. Le pouvoir de l'image
Conférence par Pascal Blanchard, historien, chercheur associé au CRHIM à l’université de Lausanne (Suisse), codirecteur du Groupe de recherche Achac (Paris), est spécialiste en histoire contemporaine et de l’histoire coloniale.
La fin de l’empire colonial français et la guerre d’Algérie, se sont aussi accompagnées d’une guerre des images et de propagande. En fait, cette « guerre des images » a commencé quelques décennies plus tôt et c’est ce contexte propagandiste qui permet de comprendre et de regarder autrement ce conflit.
A partir du livre Colonisation & propagande. Le pouvoir de l'image, l’historien Pascal Blanchard plonge dans plus d'un siècle de propagande, de la IIIe République naissante (1870) à la chute de l’Empire (1962), montrant que la propagande coloniale a fait partie du quotidien des Français. Tous les supports ont participé à cette apologie de la « plus grande France ». Au cœur de l'Etat, une Agence des colonies a été le fer de lance de cette propagande, et beaucoup ont oublié son action. Génération après génération l'idée coloniale a fait son chemin, pour devenir consensuelle durant l'entre-deux-guerres et se prolonger jusqu'aux dernières heures de l'Algérie française et même au-delà. Cette approche inédite sur l’histoire coloniale, mais aussi politique et historique, participe au travail de déconstruction en cours sur l'héritage de la colonisation, nous permettant de regarder autrement ce passé et ses résonances dans le présent.
La séance s'est clôturée avec une séance de dédicaces de son ouvrage organisée en partenariat avec la librairie Dallongeville Gerboux.
La France libérée (1944-1947)
Conférence par Michel Winock, immense historien, professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste de l’histoire de la République française et des mouvements intellectuels contemporains et fondateur de la revue L’Histoire.
Été 1944 : la 2e DB entre dans Paris, ouvrant le sacre républicain de Charles de Gaulle aux Champs-Élysées. Un vent d'espoir se lève, appelant à l'édification d'un nouveau régime et d'une nouvelle société. Trois ans plus tard, cet espoir est brisé. La guerre froide acte une autre partition du monde, tandis que la IVe République naissante reproduit l'instabilité de la IIIe et l'éternel retour des partis. Chroniqueur inspiré de cette période oubliée, alors qu'elle se révèle d'une richesse inouïe, Michel Winock a choisi de la raconter au moyen des grands événements non seulement politiques, mais aussi culturels, judiciaires et sportifs afin d'offrir un tableau global.
Un voyage de la Libération à l'épopée de l'Exodus en passant par l'épuration, la crise coloniale, le départ de De Gaulle et la naissance du RPF, la position centrale du PCF et les grandes grèves de 1947, mais aussi le tribunal de Nuremberg et le procès Petiot, Sartre et Camus, la loi Marthe Richard, le premier festival de Cannes et le grand retour du Tour de France. Une enquête historique qui interroge plus largement sur le mystère français, ses sempiternelles divisions jurant avec son idéal universaliste et sa capacité à conjurer les épreuves.
La séance s'est clôturée avec une séance de dédicaces de son ouvrage sur la question organisée en partenariat avec la librairie Dallongeville Gerboux.
Une obsession française : le roi absolu, de François Ier à Louis XIV (1515-1715)
Conférence donnée par Joël Cornette, agrégé d’histoire, professeur émérite à l’université Paris 8-Vincennes.
Du premier Capétien au dernier des Bourbons, la tentation et l’affirmation « absolutistes » n’ont cessé d’être la marque de la monarchie française, son ADN en quelque sorte. Les deux siècles encadrés par les règnes de François Ier et de Louis XIV constituent un effervescent laboratoire politique. Il expérimente des formes de gouvernements centrés sur la personne royale.
Le corps du souverain, « fort » (François Ier, Henri II, Henri IV, Louis XIV), ou « faible » (François II, Charles IX, Henri III, Louis XIII dans une certaine mesure) constitue le moteur de cette quête du pouvoir absolu : les épisodes de troubles, d’oppositions, de guerres civiles ou religieuses, sont contemporains d’un roi enfant, absent, décrédibilisé, à l’exemple des guerres de Religion (1562-1598) ou de la Fronde (1652-1652). Cette hyperpersonnalisation de la puissance est la contribution française à l’histoire de la souveraineté, une spécificité qui a traversé les siècles, les régimes, les révolutions. Jusqu’à notre monarque républicain.
La séance s'est clôturée avec une séance de dédicaces des ouvrages Le roi absolu. Une obsession française 1515-1715 (Tallandier, 2022) et Anne de Bretagne (Gallimard, 2021) organisée en partenariat avec la librairie Dallongeville Gerboux.
La société française et les voleurs (XIXe-XXe siècles)
Conférence par Arnaud-Dominique Houte, professeur d’histoire contemporaine à Sorbonne-Université. Il est notamment l'auteur de Propriété défendue. La société française à l’épreuve du vol. XIXᵉ-XXᵉ siècles (Gallimard, 2021 - Prix du livre d'histoire du Sénat 2021) et Le métier de gendarme au XIXe siècle (PUR, 2010).
Le vol est une des réalités les mieux partagées (hélas) de notre expérience sociale. S’agit-il pour autant d’un phénomène atemporel, qui échapperait à l’Histoire ? Certainement pas, et le conférencier s'est intéressé dans cette présentation, devant une quarantaine de personnes à expliquer les évolutions contemporaines de notre sensibilité au vol et aux voleurs.
Au XXème siècle dans une France qui célèbre la propriété, la protection des biens inspire des politiques de sécurité publique et des pratiques de surveillance privée (les serrures se renforcent, les chiens aboient, les voisins épient). Solidement enraciné, ce consensus propriétaire résiste au défi des contestations politiques, des crises et des guerres, mais il cède sous la pression des mutations sociales et culturelles qui s’accélèrent avec les années 1960-1970. Au temps des assurances et de la consommation de masse, le vol n’est plus la menace prioritaire ; plus banal, il n’en reste pas moins le principal facteur de l’insécurité moderne.
La séance s'est clôturée avec une séance de dédicaces, organisée en partenariat avec la librairie Dallongeville Gerboux.
Achever, transformer et restaurer la cathédrale de Noyon de 1200 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
A l'occasion de ses travaux de recherches sur la cathédrale de Noyon, la conférence donnée par Hugo Freby, doctorant en histoire de l’art médiéval à l’université de Picardie Jules Verne, avait pour objet de déterminer l’ampleur des modifications et réparations depuis l’achèvement du gros œuvre aux environs de 1200, de les contextualiser et d’identifier les causes qui les ont motivées, en distinguant les entreprises de sauvegarde, d’embellissement, d’adaptation aux usages liturgiques et les remises en état consécutives aux incendies et aux guerres. C'est donc un regard neuf que nous a proposé ce jeune chercheur sur la cathédrale devant une cinquantaine de personnes présentes.
L'assemblée générale de la société était organisée, après la communication sous la présidence de Jean-Yves Bonnard, en présence de plus de 30 personnes présentes et de nombreux pouvoirs.
Jeanne d'Arc. Héroïne diffamée et martyre
Bilan annuel du Service département d’archéologie de l’Oise
Samedi 13 novembre 2021 - Nicolas Offenstadt
Que reste-t-il de la République Démocratique Allemande (RDA) ?
Sur les traces d'un pays disparu
Conférence par Nicolas Offenstadt, maître de conférences habilité à diriger des recherches à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Vendredi 22 et samedi 23 octobre 2021
Colloque : Les années 20 dans l'Oise
Le colloque des sociétés historiques de l’Oise, organisé à Crépy-en-Valois, se proposait de réfléchir sur les années 1920 dans l’Oise, depuis la fin de la Grande Guerre jusqu’au début des années trente marquées par l’entrée dans la crise économique.
Samedi 5 juin 2021 - Rémi Duvert
Soie et pneus : hauts et bas de l’usine de Clairoix (1926-2016)
Conférence illustrée par Rémi Duvert, historien amateur et membre fondateur de l'association « Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix ».
Devant une vingtaine de personnes, selon la jauge demandée, Rémi Duvert, a présenté l’histoire de l’usine de Clairoix : une éphémère filature de soie, transformée en une manufacture de pneus Englebert, puis Uniroyal, puis Continental.